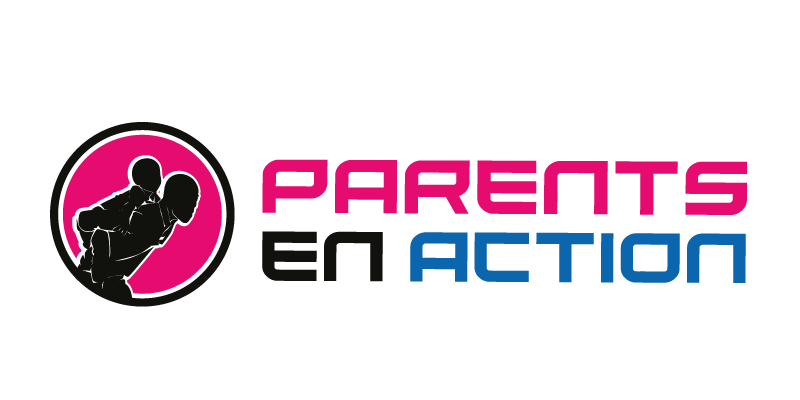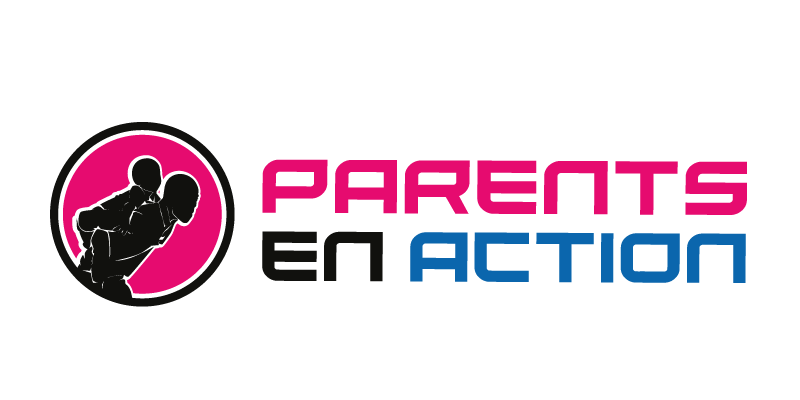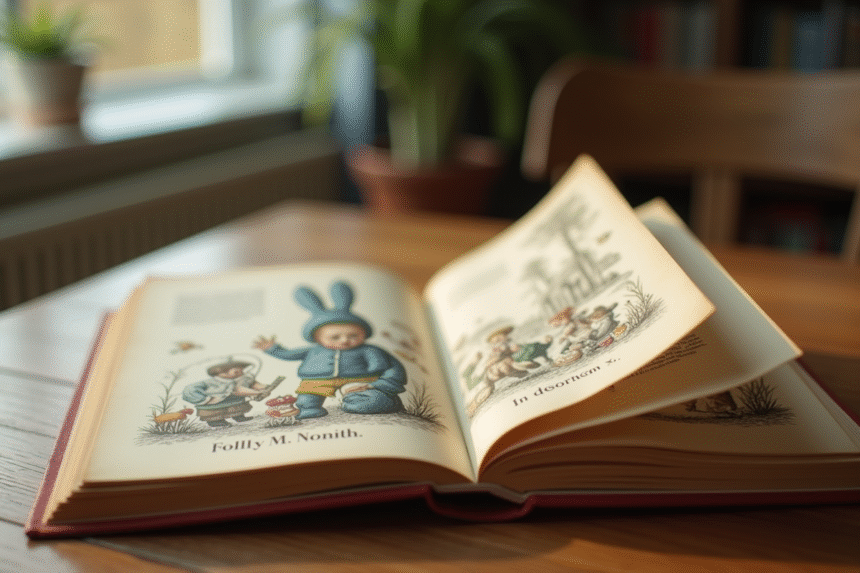La question du genre de Oui-Oui divise éducateurs et spécialistes depuis plus de soixante-dix ans, malgré l’absence de consensus dans les textes officiels et les adaptations successives. Les manuels scolaires des années 2000 font référence au personnage au masculin, tandis que certaines traductions étrangères optent pour le féminin.
Ce flottement alimente les discussions sur la représentation des genres dans les supports éducatifs et sur la portée des modèles proposés aux enfants. Plusieurs institutions ont déjà intégré cette incertitude dans leurs démarches pédagogiques, afin de questionner les stéréotypes et promouvoir l’égalité.
Oui-Oui, un personnage au cœur des questions de genre
Depuis 1949, Oui-Oui (ou Noddy, dans la version anglaise), créé par Enid Blyton, intrigue sans relâche petits et grands. Illustré par Harmsen van der Beek puis Jeanne Hives pour les éditions françaises chez Hachette, ce résident de Miniville ne cesse de provoquer des interrogations. Son prénom évoque l’enfance, sa silhouette n’appartient à aucun genre défini, et sa tenue colorée lui confère une identité aussi ouverte qu’intemporelle. D’ailleurs, rien dans ses traits ni dans ses vêtements n’impose une identification précise. Ce positionnement, loin d’être anodin, interroge la manière dont la littérature jeunesse aborde la question du genre.
Les multiples adaptations à l’étranger, albums, dessins animés, jouets, costumes, déclinent Oui-Oui sous d’autres noms, comme Zvonko, Nicke ou Lelumaan Niksu, signe d’une capacité à traverser les frontières culturelles. Les versions pédagogiques hésitent : garçon ou fille ? En France, la tendance penche du côté masculin, renforcée par le choix des pronoms dans les textes et les doublages. Pourtant, rien ne s’impose réellement : short rouge, bonnet à grelot, chaussures jaunes, tout reste exempt de signification sexuée.
Les enfants, eux, s’approprient Oui-Oui librement. Pour certains, c’est un complice de jeux, pour d’autres, une présence rassurante parmi Potiron, Mirou, Sournois ou Finaud. L’ambiguïté de genre devient alors un terrain d’exploration, un miroir où chacun projette ses propres repères. Ce flou dérange parfois les adultes, mais il offre surtout aux enfants la possibilité de penser autrement, loin des cadres imposés par la société.
Pourquoi l’identité de Oui-Oui suscite-t-elle autant de débats ?
La singularité de Oui-Oui ne date pas d’hier. À chaque génération, la même interrogation revient : ce personnage, ni franchement fille ni vraiment garçon, détonne dans l’univers des héros d’enfance. Parents, enseignants, enfants eux-mêmes projettent sur Oui-Oui leur propre vision du genre.
Ce n’est pas un hasard si Oui-Oui conserve cette part de mystère. Dès l’origine, vêtements neutres, absence de signes distinctifs et prénom sans indication claire laissent la porte ouverte à toutes les interprétations. En France, le masculin domine côté pronom et codes vestimentaires, mais ce choix n’est jamais exclusif. Résultat : chacun y va de son analyse. Certains y voient le signe d’une volonté d’inclusion avant l’heure, d’autres n’y lisent qu’un produit de son époque, indifférent aux débats d’aujourd’hui sur les représentations de genre.
Plusieurs raisons expliquent la diversité des perceptions :
- Les enfants s’identifient à Oui-Oui selon leur propre ressenti, sans se sentir contraints.
- L’ambiguïté entretenue autour du personnage rend possible l’appropriation par toutes et tous.
- La littérature jeunesse, avec Oui-Oui en figure de proue, propose un espace où la liberté prime sur la biologie ou l’apparence physique.
La question « fille ou garçon ? » n’est finalement qu’un prétexte pour interroger nos propres normes. Ce débat en dit long sur l’impact des modèles proposés aux enfants et sur la manière dont la société façonne, dès les premières années, la perception du genre.
Stéréotypes de genre : comment les histoires pour enfants influencent nos représentations
Dès le plus jeune âge, albums illustrés et dessins animés construisent une idée du genre qui s’infiltre jusque dans les jeux et les discussions en famille. Les histoires, personnages, et même la couleur des jouets, orientent discrètement la façon dont chacun se perçoit et perçoit les autres. Le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) met régulièrement en avant la puissance de ces modèles : une majorité de jouets, de costumes et de récits perpétuent l’idée que douceur rime avec fille et audace avec garçon.
L’univers de Oui-Oui, disponible en albums, dessins animés et jouets, influe sur ces représentations. C’est justement l’indétermination de son identité qui ouvre la voie à d’autres possibles. Chacun peut s’identifier à Oui-Oui, peu importe son genre. Pourtant, les progrès restent lents. Les catalogues de jouets persistent à séparer l’univers « fille » du monde « garçon » : rayons roses contre rayons bleus, scénarios genrés, tout cela résiste, malgré des efforts de mixité engagés par certains acteurs ou des accords pour une représentation plus équilibrée.
Voici quelques leviers qui façonnent ces représentations chez les plus jeunes :
- Les jouets, costumes et histoires d’aventures participent à la construction des rôles qui semblent attendus.
- Les initiatives publiques cherchent à renforcer la mixité, mais le marché conserve ses habitudes.
- La littérature jeunesse, quand elle s’affranchit des codes, permet d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les genres.
Albums et dessins animés, loin d’être neutres, influencent profondément la manière dont l’égalité se vit et s’apprend au quotidien. Les alertes du HCE rappellent que la bataille se joue autant dans les livres que dans la cour de récré.
Des outils concrets pour promouvoir l’égalité filles-garçons en classe
À l’école, les enseignants disposent de nombreux supports pédagogiques pour aborder la question du genre dès la maternelle. Les programmes officiels prévoient des séquences sur l’égalité filles-garçons : analyse d’illustrations, lectures, débats à partir d’albums jeunesse ou de dessins animés. Ces supports, élaborés en collaboration avec des chercheurs en sciences sociales ou validés par le Haut Conseil à l’Égalité, aident à déconstruire les stéréotypes et à lancer le dialogue.
Un album comme Oui-Oui, justement parce que son genre n’est pas fixé, offre un point de départ idéal. Certains enseignants demandent : pourquoi ce personnage porte-t-il un short ou une jupe ? Qui peut conduire la fameuse voiture de Miniville ? En posant ce genre de questions, les élèves découvrent qu’il existe bien des façons d’être et de faire. Les ateliers d’écriture ou de théâtre poursuivent cette démarche en invitant à inventer d’autres histoires, à réécrire les rôles ou à brouiller les codes.
Différents outils sont mis à disposition pour favoriser ce travail en classe :
- Les séquences de lecture reposent sur des ouvrages où le genre reste ouvert ou peu marqué.
- Les discussions collectives encouragent chacun à s’exprimer sans crainte du regard des autres.
- Des supports audiovisuels, extraits de dessins animés, affiches, servent de points de départ pour interroger les normes.
En France, où Oui-Oui a vu le jour chez Hachette, les ressources ne manquent pas : guides pédagogiques, affiches, jeux de rôles alimentent le travail des enseignants. Chacun adapte ces outils à la réalité de sa classe, dans l’idée de construire, ensemble, une culture partagée de l’égalité, bien au-delà d’une simple répartition des rôles.
Dans la cour de récréation comme dans les livres, le genre de Oui-Oui reste une énigme féconde. Et si cette incertitude, au lieu de déranger, ouvrait tout simplement la porte à plus de liberté pour tous les enfants ?